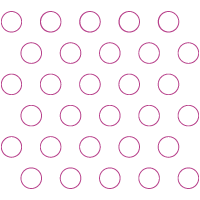
Patrimoine
L’église Saint Georges
L’église Saint-Georges est l’une des plus vastes églises rurales gothiques de Seine-et-Marne. Édifiée au début du XIIIe siècle, à une époque où Guérard prospérait grâce à la culture de la vigne, elle témoigne de la puissance du prieuré et de la richesse du village. L’édifice actuel a souffert de restaurations successives, en particulier celle de 1850 qui a cependant évité le pire ! Il était alors question de raser l’édifice, pour construire une nouvelle église. Sous l’impulsion du curé de l’époque, la municipalité choisit finalement d’abattre le clocher médiéval qui était construit à la travée du transept et menaçait de s’écrouler. À la place, est édifié un clocher-porche de 40 mètres de haut, qui cache malheureusement le portail du XIIIe siècle, mais donne à l’église une allure élancée repérable depuis les hameaux.
- Ouverte tous les jours





La terrée
Attenant à l’ancienne porte de Provins, le rempart de Guérard constitue un témoin exceptionnel de l’architecture défensive utilisée pendant la Guerre de cent ans puis pendant les guerres de religion (du milieu du XIVe au XVIIe siècle). Ce type de fortification en terre, appelé terrée, est un vestige d’une grande rareté.
À Guérard, il a été en partie préservé grâce à son utilisation en tant que clôture d’une propriété privée. Au total, ce rempart ou « terrée » est haut de 4,5 m et large d’environ 6 mètres. D’après le plan de 1741, il était flanqué de 7 tours dont il ne reste qu’un exemplaire, très remanié au XIXe puis au XXe siècle, et bordé par un fossé sec, dont le creusement a servi à construire la terrée (comblé au début du XXe). Il était surmonté d’un chemin de ronde bordé par un mur de type parapet.
La plaque du Phylloxéra
Commandée vers 1900 par Laurent Pochet, un vigneron local passionné et engagé, elle témoigne du traumatisme causé par l’arrivée de ce minuscule insecte qui, à la fin du XIXe siècle, décima les vignes de la région et provoqua l’effondrement du vignoble guérardais.
En 1893, alors que le phylloxéra est détecté dans la vallée du Grand Morin, les vendanges s’annoncent catastrophiques. À Guérard, la tension monte. Le 20 août, jour d’élections, Laurent Pochet est pris à partie par des vignerons en colère qui l’accusent, à tort, d’avoir introduit le parasite lors de ses voyages. C’est dans ce contexte qu’il fait réaliser une plaque commémorative, véritable monument funéraire à la mémoire du vignoble local.
Elle est désormais visible sur la façade de la mairie de Guérard, tandis qu’une copie est installée à son emplacement d’origine, à Monthérand.



Les lavoirs
Autrefois essentiels à la vie quotidienne, les lavoirs étaient nombreux et bien répartis sur le territoire de la commune. Certains utilisaient l’eau vive du Grand Morin et d’autres captaient des sources, souvent considérées comme potables, appelées alors fontaines.
Plus d’une dizaine de ces lavoirs ou de leurs vestiges sont encore visibles aujourd’hui, du lavoir de la Fontaine au Camus à Montbrieux, restauré en 2012, à celui de Genevray, remis en valeur en 2016. La plupart étaient construits à ciel ouvert mais entourés de murs, à la manière des atriums romains, ce qui permettait de protéger les lavandières tout en profitant de la lumière du jour. Une balade au fil de ces fontaines anciennes est une belle manière de redécouvrir le patrimoine rural de Guérard.
Les croix
Autrefois très présentes dans le paysage rural, les croix jalonnaient les chemins de Guérard. Très répandues à partir du XVIe siècle, elles servaient à la fois de symboles religieux et de marqueurs de limites administratives (fiefs). En tout, dix-huit croix sont recensées dans l’histoire de la commune.
Aujourd’hui, seulement cinq sont encore visibles :
• La croix de Fer, à Courtry
• La croix Saint-Georges, dans la côte de Guérard à Montbrieux
• La croix Jacquée, route de la gare
• La petite croix Saint-Marc, à Monthérand
• Et la croix de Verre, à l’angle de la Grande Rue et de la rue des Violettes, la seule à porter encore un Christ sculpté.



